On a rarement entendu autant de reniflements en séance officielle à Cannes que pour la projection de 120 Battements par minute. Ni autant d’applaudissements après. Couronné d’un Grand Prix, le nouveau film de Robin Campillo, scénariste d’Entre les murs et réalisateur de l’excellent Eastern Boys, a pris les festivaliers à la gorge et est passé très près de la Palme d’or.En conférence de presse, Pedro Almodovar a avoué à demi-mot que si ça n’avait tenu qu’à lui il la lui aurait donnée.
Situé dans les années 90, au plus fort des ravages du Sida, le film fait revivre le combat des militants d’Act-Up pour donner de la visibilité aux malades, que la société préférait cacher dans les hôpitaux.Quand elle ne les désignait pas comme responsables de l’épidémie.On suit un groupe d’une dizaine de jeunes militants d’Act-Up Paris, depuis une de leurs premières actions de perturbation d’un congrès de l’Association Française de Lutte contre le Sida (jugée trop attentiste et proche du pouvoir) en 1989, jusqu’au décès de l’un d’eux.En passant par les premières Gay Pride et les manifestations contre le sang contaminé. La reconstitution des actions et des réunions hebdomadaires de l’association est tellement réaliste qu’on croirait assister à un documentaire. «J’ai été moi-même militant à Act Up au début des années 90, raconte Robin Campillo. Il y a longtemps que je pense à faire un film sur ces années-là, mais je ne trouvais pas le bon angle. En réalité, j’avais surtout peur de me frotter à un sujet qui a été si important dans ma vie. Aujourd’hui, ce n’était plus une question d’actualité.Je me suis tout simplement dit qu’il était temps de me jeter à l’eau». Pour arriver au niveau de réalisme du film, le réalisateur explique avoir tourné les scènes de meetings à trois caméras, en s’inspirant du dispositif éprouvé avec Laurent Cantet sur Entre les murs. «Pour que les comédiens trouvent le ton juste, nous avons fait trois jours de répétition dans un amphi, poursuit le réalisateur.J’ai pas mal réécrit les dialogues après pour faire évoluer les scènes qui ont été tournées très vite et d’un seul tenant». Sur la langue particulière du film, que Robin Campillo qualifie de «parlé pédé», le réalisateur explique avoir cherché à retrouver «la musicalité des assemblées d’Act-Up», avec notamment ces fameux claquements de doigts qui remplacent les applaudissements pour que les débats restent fluides: «Il fallait que les comédiens aient un langage militant.Mais je ne voulais pas que cela ressemble aux débats de l’Assemblée Nationale. À cette époque la parole s’est enfin libérée après avoir été occultée pendant les dix premières années de l’épidémie. C’était un moment à la fois joyeux et tragique. Le flot de paroles du film illustre ce moment libérateur. D’un seul coup, il y avait la volonté de briser un silence qui n’avait que trop duré».
De jeunes acteurs épatants
Mais le réalisateur s’intéresse finalement moins aux actions historiques d’Act-Up (qu’il se garde bien d’héroïser ou de glorifier), qu’à ses personnages, fictifs bien qu’inspirés de militants réels de l’association. C’est sans doute pour cela que 120battements par minute est aussi bouleversant.Ces jeunes gens, qui savent qu’ils vont mourir, sont terriblement attachants.Et les comédiens qui les incarnent sont tous excellents.A commencer par Nahuel Perez Biscayart qui joue Sean, héros sacrificiel du film «J’ai passé beaucoup de temps au casting pour vérifier l’alchimie entre les comédiens, les contrastes de jeu. On a mis beaucoup de temps pour trouver le bon équilibre, raconte Robin Campillo. Sur le tournage d’Eastern Boys, l’histoire d’un homme qui se faisait envahir chez lui, je me suis dit que ce pourrait être comme un horizon éthique pour mon prochain film. Au lieu d’essayer de tout contrôler sur le plateau, j’avais envie de me laisser envahir par mes acteurs et de les regarder faire le film».
Le fait que le réalisateur ait partagé l’aventure d’Act-Up donne évidemment au film une crédibilité et une véracité qu’il n’aurait probablement pas eu autrement et qui l’empêche de sombrer dans le pathos.Y compris dans les scènes finales, les plus tsensibles: «J’ai vécu des choses qui sont dans le film, comme rhabiller un copain mort, confie Campillo. Dans la réalité ça se fait très simplement, parce qu’on est totalement dans le moment. J’ai essayé de le montrer comme cela, en laissant l’émotion ressortir de ces gestes simples. Il fallait éviter d’en rajouter: les faits sont assez durs comme cela».
La musique a également une grande importance dans le film, au point de lui inspirer son titre: «120 battements par minute, c’est le rythme de la musique house qu’on écoutait, explique le réalisateur.Tous les militants n’allaient pas en boite faire la fête en écoutant de la techno mais elle a quand même largement accompagné le mouvement.C’est une musique à la fois festive et inquiète qui représente bien ce que traversait la communauté gaie à l’époque. Le titre fait aussi référence à l’adrenaline du combat, aux battements du cœur qui s’emballe pendant l’acte sexuel.Il me paraissait parfaitement approprié».
L’expérience d’Act-Up pourrait-elle s’appliquer à d’autres combats aujourd’hui? Et en cela le film a-t-il une vocation militante?Robin Campillo reste très mesuré sur la question: «Je n’ai pas fait ce film pour donner des conseils de militance, mais pour rappeler ce qu’était Act-Up. Le mouvement était très minoritaire, y compris dans la communauté homosexuelle.Mais en même temps, il y avait toujours 100 à 15O personnes aux réunions hebdomadaires.C’était le seul groupe politique où la participation était aussi importante. Tant mieux si ce film peut réveiller les consciences.Mais un mouvement comme celui-là ne se crée que sur un besoin incandescent. Ces gens-là n’avaient pas le choix, c’était le combat de leur vie». On sait gré au réalisateur d’avoir su trouver le ton juste pour leur rendre hommage. 120 battements par minute est probablement le meilleur film français qu’on verra cette année. Il devrait tout raffler aux César.
Une Femme douce: voyage en absurdie
-
Une femme (Vasilina Makovtseva) se voit retourner sans explication le colis qu’elle a envoyé quelque…
-
26 Aug 2017
Nés en Chine
-
Yaya, une maman panda guide son petit Mei Mei alors qu’il explore le monde et gagne en indépendance.…
-
25 Aug 2017
See all articles...
Authorizations, license
-
Visible by: Everyone (public). -
All rights reserved
-
53 visits
120 battements par minute: passage à l'Act-Up
Jump to top
RSS feed- Latest comments - Subscribe to the feed of comments related to this post
- ipernity © 2007-2024
- Help & Contact
|
Club news
|
About ipernity
|
History |
ipernity Club & Prices |
Guide of good conduct
Donate | Group guidelines | Privacy policy | Terms of use | Statutes | In memoria -
Facebook
Twitter
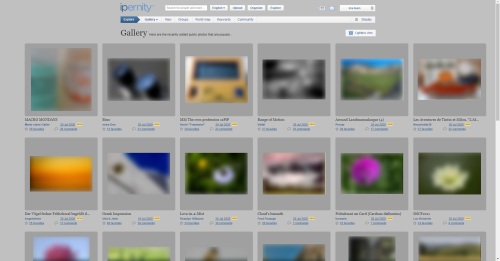
Sign-in to write a comment.