Lou Reed en coffret
-
Trois ans déjà que Lou Reed s’en est allé, laissant derrière lui une œuvre aussi riche et variée que…
-
03 Feb 2017
La La Land: sur un nuage
-
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia (Emma Stone) sert des cafés entre deux…
-
03 Feb 2017
See all articles...
Authorizations, license
-
Visible by: Everyone (public). -
All rights reserved
-
85 visits
Rencontre avec Patrick Bruel
Il dit avoir hésité à accepter de faire le film: «Le devoir de mémoire, bien sûr, mais j’avais l’impression d’avoir déjà pas mal donné».Patrick Bruel aurait eu tort de refuser. Il est impeccable dans la nouvelle adaptation du roman de Joseph Joffo, Un sac de billes: l’histoire de deux jeunes enfants juifs que leur père envoie rejoindre, seuls, le sud de la France pour échapper aux rafles dans Paris occupé par les Allemands. Sobre, juste et émouvant, Bruel trouve dans ce rôle de père un de ses meilleurs emplois au cinéma…
Qu’est-ce qui vous a finalement décidé?
Comme je me posais plein de questions sur l’opportunité de faire ce film, j’ai dit au réalisateur qu’il faudrait que les deux enfants soient vraiment exceptionnels pour que ce soit réussi.Il m’a alors montré leurs essais et j’ai été sidéré.Ca s’est d’ailleurs confirmé au tournage: ils sont incroyables, surtout le petit Dorian qui joue Joseph.Ce môme, c’est Leonardo Di Caprio! Bref, ce sont les enfants qui m’ont convaincu.D’autant qu’ils ne connaissaient rien à l’histoire.je veux dire pas seulement celle des Joffo, celle de l’occupation, de la Shoah.Ils l’ont apprise en lisant le livre que leur père les a forcés à lire comme la mienne l’avait fait à leur âge.
Quels souvenirs gardiez-vous du roman?
À l’époque, chez moi, il fallait l’avoir lu.Ce n’était pas négociable.C’était plus important que Molière.C’était le début du travail de mémoire après les années d’occultation et d’oubli impossible. Mais j’ai gardé un trés bon souvenir de la lecture du roman.J’espère que le film pourra parler aux enfants d’aujourd’hui comme le livre nous a parlé à nous à l’époque.
Ca vous paraît important d’y revenir aujourd’hui?
C’est vrai, il y a eu Le Pianiste, La Liste de Schindler, Un secret dans lequel j’ai joué et tous ces films sur la Shoah… Mais il y a longtemps qu’il n’y a pas eu un film qui passe par le regard d’un enfant. Depuis Au revoir les enfants de Louis Malle, je ne crois pas qu’il y en ait eu. Et finalement ce n’est pas un film de plus. C’est une belle aventure cinématographique dont on ne peut pas nier le caractère utile et pédagogique.
Ce rôle de père a dû vous marquer?
Certes, l’image du père est sublimée, dans le roman et dans le film, par son fils qui lui voue un amour inconditionnel.Il a été son guide, sa référence, et en plus il est mort, prenant ainsi une dimension symbolique totale. Mais on ne peut pas lui nier le courage de faire partir ses deux enfants, en pleine nuit. Son extraordinaire réactivité les a sauvés. Difficile de ne pas y penser quand on doit expliquer à ses propres enfants ce qui se passe après les attentats de novembre à Paris.
Peut-on établir un parallèle entre le film et la période actuelle?
Comment ne pas le faire? On a commencé à tourner au lendemain du 13 novembre et je peux vous dire qu’on n’avait pas besoin de se forcer pour jouer l’émotion. Depuis la crise de 2008, on a vu la montée des nationalismes européens, le repli sur soi, les discours xénophobes, les boucs émissaires… Ca rappelle des choses, non? On repart en 1929.Les conséquences ne sont pas encore là, mais elles vont arriver…
Le voyage des deux enfants pourrait aussi être comparé à celui des migrants…
Je sais que Christian Duguay a fait ce rapprochement, mais il faut faire attention aux raccourcis. On ne peut pas faire de comparaison. Sauf à dire que, comme pour ces deux enfants, il n’y a heureusement pas que du silence complice. Il y a aussi des gens magnifiques qui accueillent des réfugiés chez eux, qui les aident. Il y a des municipalités qui ont fait beaucoup d’efforts. Il y a des intégrations réussies…
Quels souvenirs gardez-vous du tournage à Nice?
C’était très agréable, mais court: deux jours à peine pour Elsa et moi.Au point que j’avais presque oublié qu’on avait tourné ces scènes sur la Promenade des Anglais.Quelle émotion de revoir les images dans le film après ce qui s’est passé…
Jump to top
RSS feed- Latest comments - Subscribe to the feed of comments related to this post
- ipernity © 2007-2024
- Help & Contact
|
Club news
|
About ipernity
|
History |
ipernity Club & Prices |
Guide of good conduct
Donate | Group guidelines | Privacy policy | Terms of use | Statutes | In memoria -
Facebook
Twitter
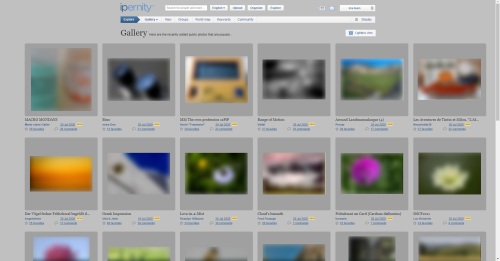

Sign-in to write a comment.