Un petit texte que j'ai pendant longtemps essayé d'accoucher sous forme d'un poème. Je n'ai pas réussi et je l'ai donc écrit en version longue. Un auteur célèbre avait écrit à la fin d'une lettre de plusiseurs pages envoyée à un ami : "Excuse moi mais je n'ai pas eu le temps de faire court". Effectivement, faire court demande du temps, de la technique et du talent. J'ai manqué des trois et c'est donc un texte en demi-teinte que je vous livre.
C'est un texte quasiment au premier degré, outrageusement romantique et j'espère que vous ne serez pas chagriné par l'excès de lyrisme.
J’y suis retourné.
J’ai d’abord suivi la longue haie qui commence là où s’arrête la route cahotante qui m’a conduit là-bas. C’est cette belle haie parsemée d’aubépines, que tu avais comparée à un collier de perles blanches égrenées sur un écrin de velours vert, qui nous avait poussés la première fois à faire le détour et à découvrir cet endroit. Notre endroit.
Arrivé au bout de la haie, j’ai tourné à gauche et je me suis assis quelques instants dans l’herbe fraîche du grand champ, comme tu le faisais souvent, pour admirer la petite vallée et plus loin, de l’autre côté, le damier des prés qui en été s’illumine du jaune soleil des colzas et se tempère du vert tendre des jeunes lins.
J’ai traversé le champ en ligne droite et j’ai ensuite emprunté le chemin creux bordé de noisetiers où tu aimais courir au printemps et chercher des noisettes ou des mûres à l’automne. Au fur et à mesure que nous avancions sous la voûte ajourée, tes joues s’empourpraient, tes yeux s’éclairaient et mon cœur s’allégeait.
En débouchant à la lumière, j’ai froncé les yeux, je devais avoir cette figure qui te faisait tant rire et que tu essayais vainement de reproduire en grimaçant et en tournant autour de moi. J’ai marché lentement dans la grande prairie en pente douce que tu avais plus d’une fois dévalée en te laissant rouler jusqu’en bas. Jusqu’à arriver dans l’eau.
Tu disais que c’était une rivière qui serpentait là et moi je soutenais que ce n’était qu’un gros ruisseau. Tu avais tranché en le baptisant Amour, comme ce fleuve qui coule quelque part entre la Chine et la Sibérie… et j’avais capitulé. Les grosses pierres rondes que j’avais placées au milieu étaient encore là et j’ai traversé sans me déchausser. Toi tu adorais marcher pieds nus, sentir l’eau fraîche sur tes chevilles. Et tu ne manquais jamais au passage de m’éclabousser en riant et en te moquant de mes grognements agacés.
Dans le petit méandre de l’Amour qui entoure notre royaume, le grand saule n’avait pas bougé. J’ai doucement écarté le rideau vert doré et je me suis allongé à ses pieds. Cette fois, je n’avais apporté ni mousses ni fougères, je n’avais pas non plus apporté de petit panier, je me suis juste allongé, le cœur plein et le regard vide.
La vallée était calme, j’entendais les remous du ruisseau, le chant des insectes et le bruissement du saule pleureur mais pas les battements de ton cœur.
Les rayons lumineux dessinaient des motifs mystérieux à travers la chevelure dorée du saule centenaire et les tâches de lumière dansaient au hasard des humeurs du vent. Quelques pétales d’aubépine égarés venaient se poser dans ce havre paisible. Quand une de ces larmes blanches touchaient l’un d’entre nous, tu disais qu’il avait remporté un baiser. Tu gagnais souvent. Même quand les aubépines ne fleurissaient plus depuis longtemps.
Tu affirmais que c’était sûrement la chambre d’air et d’eau où Merlin s’était laissé enfermer par Viviane qui voulait l’y aimer pour l’éternité. Que c’est pour cet unique but qu’elle avait créé cette belle et secrète bulle diaphane à la voute parsemée d’étoiles dont l’Amour faisait le tour. Je riais, et tu m’embrassais sur la bouche pour me faire taire. Tu disais aussi que le monde recelait de nombreux endroits comme celui-ci : des morceaux égarés de paradis terrestre, des sanctuaires des anciens dieux oubliés ou tout simplement des lieux qui respiraient la magie. Il suffisait de les chercher pour les trouver. Je hochais la tête et tu m’embrassais la nuque.
Alors je te serrais fort et on essayait ensemble de chercher le peu de divinité qui sommeille en chacun de nous… je crois que plus d’une fois, nous y sommes parvenus. Après, on mangeait, on riait et on s’endormait. J’aimais te regarder dormir et je prenais mon rôle de gardien très au sérieux : aucune libellule, aucune araignée ne venait profaner ton sommeil pendant que je veillais. Parfois, sans te réveiller, je laissais quelques gouttes d’eau glacées perler sur ta peau veloutée, je contemplais alors les plus scintillants des diamants sur la plus douce des soieries. A ce jour, je n’ai rien vu de plus beau.
Je crois bien que je me suis endormi. A mon réveil, la magie était partie et la bulle était brisée. Chaque fragment de ciel, chaque morceau de nuage et chaque reflet dans l’eau, étonnante magique mosaïque, m’a rappelé ton doux visage. Le vent, qui souvent avec toi chuchotait ne m’a rien dit, rien appris. Le soleil s’est caché et j’ai frissonné.
Je me suis levé. J’ai laissé le saule pleurer sur le ruisseau et l’Amour poursuivre son flot.
Il est tard. Il est temps de rentrer.
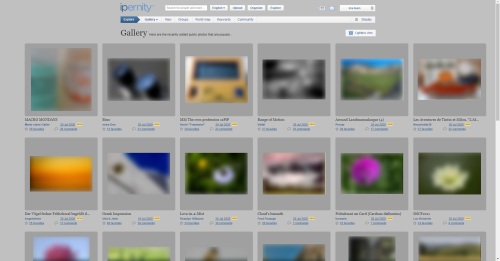
Mon 360 va disparaître comme tous les autres, mais je rapatrie mes textes scannés dans ma galerie.
Merci du passage.
Sign-in to write a comment.