L’appareil à hauteur de la poitrine, on s’approche du sujet, on déclenche sans cadrer, comme si de rien n’était. Ça marche une fois sur cinq. Et encore, les jours de chance. Cadres pourris, images floues, nombreux éléments parasites… Aucun contrôle sur quoi que ce soit. Hormis une vitesse rarement inférieure au 250è/seconde car je suis souvent en mouvement au moment du déclenchement.
En revanche, quand ça fonctionne, on obtient des images plus dynamiques que celles cadrées au millimètre. Pas facile pour moi qui aime les cadres aux petits oignons. Mais cet inconvénient présente un autre avantage qu’un surplus de dynamique - lié aussi à l’usage du grand angle et surtout à la visée en contre-plongée : Ces photos sont différentes de celles que je fais habituellement. Et en photo, c’est comme tout, il faut savoir se renouveler, sortir de sa zone de confort, se remettre en question. Ça tombe bien, les Mexicains m’imposent de changer mes habitudes.
Au Mexique, je n’ai pas eu à piquer un cent mètres. Mais j’envisageais cette éventualité. Il faut dire que malgré ma toute relative maîtrise de l’espagnol, dès que c’était possible, j’échangeais quelques mots avec la personne que je voulais immortaliser sans lui avoir demandé son consentement. Histoire de désamorcer une réaction violente, toujours possible si j'étais démasqué, à en croire les nombreux témoignages recueillis auprès d’autres photographes-voyageurs. Il faut toujours s’attendre au pire quand on s’écarte des clous. Ne dit-on pas que la photo, c’est l’anticipation ?
Une autre technique pour subtiliser une photo ni vi ni connu, est le recours à un téléobjectif ou un zoom de bonne amplitude. Le tout est de l’utiliser intelligemment. Pas comme une paire de jumelles. Là, il ne sert pas à faire des gros plans, mais à intégrer le sujet principal dans son environnement. Comme on le ferait avec un grand-angle, mais d’un peu plus loin, en raison le recul imposé par ce type de focale. Ce qui présente aussi l'avantage de limiter les risques de se prendre des oeufs ou des fruits pourris voire un coup de poing. Au pire, on a plus de chance de les voir venir. Et pour les réactions les plus agressives, cette distance de sécurité permet d'avoir quelques mètres d'avance sur un éventuel poursuivant, dans un sprint improvisé.
Sur un marché grouillant de monde, le téléobjectif est inopérant. Là, on est « battu » à tous les coups. Au moment du déclenchement, il y aura toujours quelqu’un pour passer devant l’objectif. C’est déjà un outil assez compliqué à utiliser dans des conditions normales quand on n’a pas l’habitude. De nombreux photographes puristes -dont j’ai tendance à faire partie-, détestent le téléobjectif. Hors du grand-angle, jusqu’au 50 mm, point de salut. Mais il y a des circonstances où il faut savoir transiger avec ses principes. A moins d’accepter de ne pas faire de photos. C’est un point de vue qui se défend. Mais ce n’est pas le mien, pourvu que la photo ne porte pas atteinte à la dignité et aux convictions des populations locales. Et puis il y a des scènes où l’on sent intuitivement qu'il est préférable de s'abstenir de prendre, même discrètement, la moindre image. Je l’ai ressenti lors d’une cérémonie rituelle au Chiapas où ma présence était tout juste tolérée car j’étais accompagné par des autochtones. Il faut savoir s'imposer des limites.
Si je fais de la photo, c’est pour mettre en avant les bons côtés de l’humanité. J’essaie de démontrer qu’il y a de la poésie dans la banalité du quotidien. Même dans les lieux les plus sordides. Des instants de grâce que seule la photo est en mesure de restituer et de conserver dans le temps. Le tout est de capter l’un des nombreux instants décisifs qui s’offrent à moi. Mais avec les photos volées, c’est le hasard qui mène le jeu, puisqu’on n’a pas la possibilité d’attendre, l’oeil rivé dans le viseur, que le monde s’harmonise de lui même dans le cadre.
Bon, toutes les photos prises au Mexique ne sont pas volées. Cette méthode de la street photo, je l’ai surtout utilisée sur les marchés et les villages indiens où le photographe est définitivement persona non grata. Ce qui ne veut pas dire que les indiens ne sont pas sympathiques. J’ai pu discuter longuement avec deux indiennes qui vendaient des légumes. Elles voulaient voir la photo qu’elles m’avaient vu prendre d’un commerçant ambulant, alors que je pensais avoir été d’une efficace discrétion. Discussion agréable, même si elles ne comprenaient pas l’intérêt de photographier des inconnus. Convaincu que je les avais dans la poche, je leur ai demandé si je pouvais les photographier ? Refus courtois, mais sans appel.
Là, on photographie normalement. En revanche, on se retrouve systématiquement dans une foule compacte où il faut jouer des coudes dans une marée de smartphones. Oui, les mexicains n’aiment pas être photographiés, mais ils photographient. « Faites ce que je dis, pas ce que je fais. »
Là aussi, le taux d’images ratées pourrait être impressionnant si, avec l’expérience, j'ai appris à ne déclencher qu’avec parcimonie. Une habitude héritée du temps de l’argentique. Epoque où le budget films pour un mois de voyage coûtait un bras. Un budget équivalent au prix du billet d’avion. Ça calme et oblige à réfléchir avant d’appuyer sur le déclencheur.
Même avec le numérique, pratiquer la photo dans la foule ne permet pas d’obtenir plus de trois ou quatre photos potables après plusieurs heures de déambulation. On pourrait en prendre cent fois plus, que le taux de réussite n’en serait pas supérieur. Au Mexique, plus qu’ailleurs, une bonne photo ça se mérite.
www.ipernity.com/doc/1922040/album/1187662
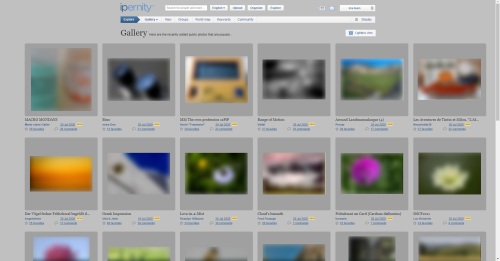



Sign-in to write a comment.