Premier film en compétition, Sleeping Beauty est aussi le premier long-métrage de l’écrivain australienne Julia Leigh. Même si elle a bénéficié des conseils avisés de Jane Campion (qui « marraine » le film à Cannes), c’est assez étonnant, car la mise en scène est sans doute ce qu’il y a de plus remarquable dans ce conte de moderne Cendrillon réduite à la prostitution. Lucy (Emily Browning, première candidate au prix d’interprétation) enchaine les petits jobs (serveuse, cobaye de laboratoire, préposée aux photocopies...) pour payer ses études. Peu farouche, elle finit par faire payer les mecs qu’elle drague dans les bars à ses heures perdues, avant de monnayer sa double expérience de cobaye et de pute en acceptant d’être livrée endormie à de vieux cochons pleins aux as par une mère maquerelle de la haute société.Les séances, confortablement rémunérées, ont lieu dans le cadre avantageux d’une grande maison bourgeoise, dont la devise est (on se demande bien pourquoi) « ni marques, ni pénétration et confidentialité absolue ». Mais la belle endormie, qui est- on l’a compris-, un peu maso, aimerait bien savoir ce qui se passe pendant qu’elle roupille...
Si l’argument, peut d’une certaine manière rappeler celui de Belle de Jour, le traitement, formaliste et glacé, se situe quelque part entre le Kubrick d’Eyes Wide Shut, les films d’Atom Egoyan et le cinéma scandinave. Ce serait vraiment épatant si cela servait un point de vue plus clairement affirmé. En brassant trop de sujets (prostitution étudiante, sexualité des jeunes et du 3e âge, solitude et désespoir de la société contemporaine, pouvoir corrupteur de l’argent...) et trop de références cinématographiques, littéraires et picturales, Julia Leigh finit par perdre sa poupée dans le coffre à jouets. Et le spectateur, resté de bois devant tant d’érotisme désincarné, rêve de se faire la belle et d’aller dormir.
Cannes 2011: We Need to Talk About Kevin
-
Au soir du premier jour, une tendance semble déjà se dessiner : ce Festival traitera premièrement de…
-
12 May 2011
Cannes 2011: glamour toujours
-
Après une édition 2010 en demi-teinte et marquée par la crise, le 64e Festival de Cannes s’annonce c…
-
09 May 2011
See all articles...
Authorizations, license
-
Visible by: Everyone (public). -
All rights reserved
-
280 visits
Cannes 2011: Sleeping Beauty
Jump to top
RSS feed- Latest comments - Subscribe to the feed of comments related to this post
- ipernity © 2007-2024
- Help & Contact
|
Club news
|
About ipernity
|
History |
ipernity Club & Prices |
Guide of good conduct
Donate | Group guidelines | Privacy policy | Terms of use | Statutes | In memoria -
Facebook
Twitter
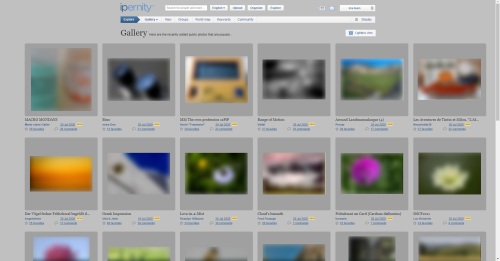
Sign-in to write a comment.