Petit prélude à ce qui va être posté par la suite, histoire de le situer dans son contexte. Je suis tombée récemment sur une réponse, postée il y a peu, au sujet de l'article que j'avais écrit sur les horaires des instits en général, et des miens en particulier. (à voir ici : www.ipernity.com/blog/linsay/535529 )
Je ne vais pas répondre aux arguments de "Fab 2", je l'ai déjà fait maintes fois avant. La seule chose que je demandais était qu'on reconnaisse notre boulot et qu'on arrête les blagues pourries aux dîners de famille (pensez-y, les fêtes approchent).
En revanche, ce qu'il a écrit ("En conclusion, oui nous reconnaissons votre travail mais vous, reconnaissez que vous avez l'un des postes les plus cools de tout ce qui se fait en France") m'a mis le coup de pied aux fesses nécessaire pour que je reprenne les notes que j'avais jetées sur le papier il y a peu, et que j'écrive ce texte. Je remercie néanmoins Fab 2 de m'en avoir soufflé le titre.
Les brumes se dissipent un peu et tu ressens l'urgence de noter. Pour ne pas oublier. Pour toi, pour d'autres dans ton cas, il faut fixer ça quelque part. Tu ne pensais pas que ça t'arriverait. Personne ne le pense. Tu as été comme tout le monde, quand ton collègue t'a parlé de ta future classe et en particulier de cet enfant. Tu as pensé qu'il exagérait un peu, qu'un enfant de neuf ans doit bien rester gérable, non ?... Tu as bien eu une petite inquiétude quand tu as appris que ce collègue avait craqué et été arrêté deux fois dans l'année (il avait quand même l'air d'un gaillard plutôt solide!).
Mais le groupe qui posait problème avait été scindé dans deux classes... bon, tu avais pêché le gros lot avec LE gamin qui partait en vrille, mais ça irait. Ca irait.
Et puis non. Dès le deuxième jour, tu t'es dit que ça allait être chaud. Dès le troisième jour, tu t'es arrêtée sur la route du retour, pour pleurer tout ton saoul et essayer d'avoir une tête présentable en rentrant chez toi. Et pendant un mois et demi, ta vie, ça a été ça. Etre en tension permanente. Toute la journée, te battre pour contenir cette cocotte-minute prête à exploser, t'en prendre plein la tête, te faire insulter, lui courir après quand il s'enfuyait de la classe et essayer de récupérer les autres élèves après ça pour continuer la leçon de maths, arrêter des bagarres dans la cour, dans la classe, t'interposer, jouer le rôle de tampon entre lui et les autres. Et culpabiliser, aussi, tellement. De ne pas être capable de t'en sortir avec lui. De ne pas avoir les épaules.
Le soir, quand tu prépares les cours en pleurant, tu te dis que ce n'est pas ça, ton métier. Ce n'est pas juste essayer de tenir bon en attendant le soir, en attendant le week-end, en attendant les vacances. Eh si.... ça peut aussi être ça, et il ne faut pas l'oublier. Mais tout le monde oublie, et c'est pour ça que tu as honte, honte d'avouer que tu n'y arrives pas. Les quelques personnes à qui tu t'es un peu ouverte de cette situation t'ont dit "fais gaffe, il faut te protéger". D'accord. Mais ça veut dire quoi, "se protéger" ? Parce qu'à part t'enfuir et ne plus jamais remettre les pieds dans cette école, tu ne vois pas trop comment te "protéger".
Alors tu essaies de tenir bon, de t'accrocher. Tu cherches, tu tentes des milliards d'aménagements qui se soldent toujours par des échecs, tu notes les jours où tu t'effondres en larmes en rentrant pour essayer de prendre du recul et voir les améliorations, mais il n'y a pas d'améliorations, tu patauges dans ton cauchemar et tu te demandes ce qui a bien pu t'arriver pour avoir envie, après plus de dix ans d'enseignement, de démissionner à la fin du mois de septembre.
Tu ne manges plus, tu as perdu 7 kilos en un mois et demi, tous les matins tes intestins te lâchent vingt minutes avant l'entrée en classe, tu t'es mise à fumer beaucoup plus qu'avant, et parfois tu te réveilles la nuit et tu te rends compte que la première chose qui te vient à l'esprit, c'est ta classe. Ton cerveau ne voit plus que cela, ça devient une obsession, "et si j'essayais ça?", et le soir tu pleures en t'apercevant que tu y penses même en te brossant les dents. Tu n'as jamais tant pleuré. Dès le matin, dans la voiture, et malgré ta sélection de CD "spéciale bonne humeur", tu sens les larmes monter, alors tu te répêtes ce leitmotiv qui te guide toute la journée. "Allez... ça va aller. Accroche-toi."
Ton chéri est patient, attentionné, inquiet, aussi. "Mais pourquoi tu ne le dis pas à l'Inspection ? Il faut que tu les appelles !" - "Ils savent, ils savent... On attend l'équipe
éducative le mois prochain." Ce que tu ne dis pas, c'est que chaque journée te semble être un mois, que le temps s'étire dans ce cauchemar et n'en finit pas.
Alors en attendant tu composes. Tu fais semblant, le peu d'énergie qui te reste passe là-dedans : tu serres les poings, tu serres les dents, tu serres les fesses, tu serres tout ce que tu peux serrer. Tu n'es plus que cela, une boule de nerfs qui se concentre très fort pour ne pas se répandre là par terre aux pieds de ceux qui lui demandent comment ça va, pour ne pas leur répondre "Eh bien écoute si on oublie le fait que le soir sur la route il m'arrive de rêver que je me prends un camion et que ce cauchemar s'arrête, ça va plutôt pas mal!" Tu penses un instant à aller voir ton médecin, mais tu sais que si tu flanches, c'en sera fini de toi, qu'il aura gagné.
Et ce "il" devient alors un ennemi. Quelque part au fond de toi tu sais encore que ce n'est qu'un enfant de neuf ans, que c'est si triste et si injuste, sa vie toute pourrie depuis la naissance... Mais tu es passée en pilotage automatique, tu as perdu ta gentillesse, ton empathie, et c'est peut-être cela le plus douloureux pour toi.
Plus que de devoir ravaler tes larmes quand après une énième crise à lui courir après tu dois retourner en classe et trouver l'énergie de dissimuler aux autres enfants que tu es effondrée à l'intérieur, plus que de devoir admettre face aux collègues que tu ne t'en sors pas, plus que de te dire que tu es une maîtresse nulle parce que ce gamin prend tellement de place qu'il ne te reste plus rien pour les autres, pour ceux qui craquent à cause de lui, pour ceux qui ont de grosses difficultés scolaires et que tu laisses sur le bord de la route.
Ce roc en toi te fait peur. Un jour, il réussit si bien à te pousser à bout que tu le prends par le bras pour l'emmener au directeur ; et tu sens bien que tu serres trop fort son bras, c'est un peu pour le contenir lui, mais surtout pour te contenir toi, car tu sens monter une bouffée de violence qui t'affole. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas comme ça. Et pourtant, ça a traversé ton esprit : tu as eu envie de le taper. Et pas de politiquement correct, tu n'as pas juste eu envie d'une "bonne claque qui stopperait l'escalade". Non. Tu as eu envie de le frapper, vraiment, de le démonter, d'ouvrir la barrière et de laisser libre cours à cet instinct des origines, à cette violence primaire refoulée. Ce jour-là, tu l'as senti, tu n'avais plus de mots, plus de recul, plus d'empathie, plus rien. Il t'avait mise à nu. Tu as compris que tu rentrais dans quelque chose de dangereux, dans un espace où tu n'étais plus toi et où tu allais te perdre.
Alors tu as craqué. Tu as demandé de l'aide à tes collègues, qui sans doute n'ont pas trop eu le choix car ils ont bien compris que tu allais leur péter entre les doigts. Un emploi du temps aménagé, deux fois par jour il sort de ta classe pour aller dans une des cinq autres, et ce sont comme deux longues respirations, pendant lesquelles tu reprends ton souffle pour mieux affronter la suite. Tu redécouvres ce que c'est qu'une classe "normale" quand il n'est pas là. Bien sûr ça reste difficile, il y a tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont des retards dans les apprentissages ou des difficultés sociales, mais enfin tu peux prendre quelques minutes pour les aider, enfin tu peux les voir et les entendre. Les vacances de la Toussaint t'ont fait du bien, tu as pu déconnecter et te ressourcer. Tu en es là, deux semaines après la rentrée de novembre. Tu te dis "ça fait deux semaines que je n'ai même pas pleuré!", comme une victoire, comme si ce n'était pas une chose naturelle. Mais quelque chose en toi demande de la prudence. Alors tu écris. Juste comme ça, au cas où. Pour ne pas oublier ce que peut être ce métier, parfois.
Goinfre
-
Revenons à nos moutons et à la fiction.
Voici un texte sans images, hormis celles qui seront dans…
-
14 Feb 2015
Saint Jean
-
Je me sens un peu comme une revenante... Sept mois depuis la dernière publication... Pour me faire p…
-
18 Oct 2014
See all articles...
Authorizations, license
-
Visible by: Everyone (public). -
All rights reserved
-
874 visits
Jump to top
RSS feed- Latest comments - Subscribe to the feed of comments related to this post
- ipernity © 2007-2024
- Help & Contact
|
Club news
|
About ipernity
|
History |
ipernity Club & Prices |
Guide of good conduct
Donate | Group guidelines | Privacy policy | Terms of use | Statutes | In memoria -
Facebook
Twitter
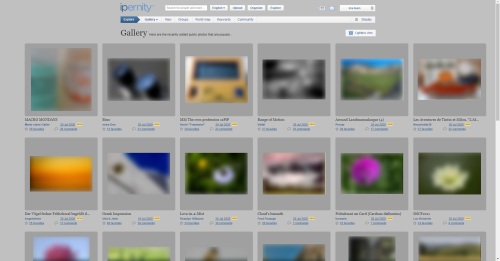

Sign-in to write a comment.