L’homme qui se tenait en face de moi, assis bien droit sur le canapé, m’a tendu une enveloppe lilas. Il s’appelait Mathieu et, pour autant que je pouvais en juger, devait avoir sensiblement mon âge. Je ne savais pas ce qu’il attendait de moi, mais ses traits tirés et les cernes sous ses yeux n’auguraient rien de bon. Il m’avait juste dit qu’il était le nouveau compagnon de Juliette. Sur l’enveloppe était inscrit mon prénom, de cette écriture fine et déliée que j’avais connue dans une autre vie. Ces six lettres à l’encre noire me faisaient chavirer. Je ne voulais pas savoir, je ne voulais pas ouvrir cette boîte de Pandore. C’était il y a longtemps, Juliette n’était plus ma femme, nous avions rompu tout contact par un accord tacite et je ne voulais plus regarder de ce côté. J’avais déménagé, changé de région, jeté tout ce qui avait appartenu à celui qui était devenu un étranger pour moi. Je ne voulais pas. Mais l’autre était là, triturant ses mains, le regard implorant. « S’il vous plaît… Je suis désolé, j’ai lu cette lettre parce que c’est tout ce qu’elle a laissé. Cela fait quatre jours déjà qu’elle a disparu, vous êtes mon seul espoir de retrouver Juliette. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi. » Une grande lassitude m’a envahi. J’ai sorti la bouteille de gin et deux verres. Il faudrait bien ça. Tout ce qu’il savait, c’est que Juliette et moi avions été mariés, et que nous nous étions séparés presque dix ans plus tôt. Il en ignorait la raison, Juliette n’ayant jamais voulu aborder le sujet. Qui était ce « Jonas » dont elle parlait dans sa lettre ? Le prénom interdit a fait disparaître le sol sous mes pieds. Je suis tombé à nouveau, happé par cette chute sans fin. Le vertige. Le vide absolu, à nouveau. J’ai ouvert l’enveloppe. « Te souviens-tu, Arthus, de ce que tu m’as dit ce jour-là en rentrant du zoo ? Cette histoire d’otarie, de compréhension soudaine et totale ? Je t’avais pris pour un fou. Je t’avais lancé à la figure tout ce qui me tombait sous la main, parce que c’était trop tôt, pour moi. J’ai compris le sens de tes mots ce matin. Je passais par le parc en allant au bureau. J’ai vu une maman qui traînait son petit garçon pour aller à l’école. Il paraissait si petit, avec son énorme cartable sur le dos. Il me faisait tant penser à Jonas que j’ai failli courir vers lui et le serrer dans mes bras. Il s’est tourné vers moi, se sentant peut-être observé, et a eu cet étrange regard. Quelque chose entre l’étonnement et la pitié. J’ai eu mon message, moi aussi, même si c’est arrivé bien plus tard que pour toi. Ses yeux m’ont dit que Jonas ne lui ressemblerait plus, qu’il aurait seize ans à présent, mais que de toute façon il n’en avait même jamais eu six. J’ai compris tout cela en une fraction de seconde. La mort, l’otarie, l’éternité. Tout. Pardonne-moi de ne pas t’avoir compris ce jour-là. » Il m’a fallu quelques secondes pour reprendre pied avec la réalité. Un gouffre béant venait de s’ouvrir dans ma poitrine. J’ai bu deux verres de gin d’affilée et j’ai regardé cet homme hagard qui, hésitant, a fini par avaler à son tour le contenu de son verre cul-sec. « On ne peut pas disparaître comme ça… », a-t-il murmuré. J’ai réprimé un rire amer. Sans doute avais-je dit une imbécilité de la sorte, onze ans plus tôt. Peut-être au gardien du zoo, ou à un flic plus tard. Ou bien à elle ? Non, pitié. Je ne sais plus. Jonas avait cinq ans lorsqu’il a disparu. Quand nous l’avons perdu. Nous avions décidé d’aller nous promener au zoo tous les trois, il aimait tellement ça, surtout les crocodiles, qu’il pouvait observer sans bouger pendant de longues minutes. Le crocodile finissait par cligner d’un oeil ou remuer légèrement sa gueule, et alors Jonas s’écriait « Ha ! Je t’ai vu ! T’es vivant, t’as bougé! ». Immanquablement. Ce jour-là rien n’était différent. Nous étions devant le bassin des otaries, collés à la vitre, observant leur ballet avec une joie enfantine. Elles plongeaient, filaient à toute allure sous l’eau puis sautaient et retombaient lourdement dans de grosses éclaboussures. Parfois l’une d’elle venait se frotter à la vitre, ou coller ses moustaches à notre nez, quelques centimètres de plexiglas pour nous séparer, à peine. Je me souviens m’être relevé en souriant. J’ai cherché Jonas des yeux pour lui dire « Tu as vu ça? », mais il n’était plus là. J’ai demandé à Juliette « Où est Jonas ?», bêtement, comme pour avoir encore juste quelques secondes de répit, quelques secondes encore dans le monde stable des gens normaux. Quelques secondes où notre fils n’avait pas encore disparu. Oh si, on pouvait disparaître comme ça. Un claquement de doigt, puis le néant. Le scénario de ce qui s’était passé, nous l’avons refait des centaines, des milliers de fois, Juliette et moi. Les peut-être ont labouré ce qui restait de nous. Peut-être qu’il avait voulu aller voir de l’autre côté du bassin. Peut-être qu’il avait continué vers les tortues de mer. Peut-être que l’odeur de barbe à papa du stand voisin l’avait attiré. Peut-être que quelqu’un lui avait pris la main. Juliette qui se réveillait en hurlant, la nuit. « J’ai cru l’entendre, il m’appelait, peut-être qu’il m’appelle en ce moment, peut-être qu’il a mal?! ». Son regard éperdu, ses cheveux de folle qu’elle ne brossait plus. Trois verres de plus effacèrent son visage de mon esprit. Peut-être que des couples se sortaient de ça à deux. Ce ne fut pas notre cas. Nous nous accrochions l’un à l’autre comme deux naufragés mais cela n’aidait en rien. Au début nous restions ensemble pour toutes les démarches, répondre aux questions, coller des affiches, demander des nouvelles de l’enquête. Ce que je faisais seul, en cachette, c’était retourner là-bas. Devant le bassin des otaries. Je pouvais y rester des heures. J’ignore ce que je cherchais, ce que j’attendais, si j’attendais même quoi que ce soit. Il fallait que j’y aille, c’est tout. Les gens du zoo étaient pleins de compassion, on me laissait rentrer gratuitement, on me souriait gentiment, on ravalait une larme devant le triste spectacle que j’offrais. On tentait de me glisser dans de la ouate, « après ce qu’il a vécu comprenez-vous », mais bien sûr rien ne pouvait me soustraire à la torture. J’étais parti bien loin des gens et de leur monde où les enfants ne disparaissent pas comme ça. Et puis, un peu plus d’un an après la disparition, cette otarie. J’étais devant le bassin depuis si longtemps, je ne sais plus. La plus grosse, la plus vieille, celle que nous appelions « la Sage » avec Jonas, s’est approchée de la vitre. Je ne me souviens de rien de cette époque, mais cette image est restée gravée en moi. Elle a incliné la tête et a planté ses yeux dans les miens. Elle a cessé de bouger pendant un court instant, et soudain, tout en me regardant, elle a relâché un gros paquet de bulles. Elle m’a délivré son message et Juliette m’a hurlé que je devenais fou quand je le lui ai dit, ce soir-là. Cela m’importait peu, puisque rien n’était sensé dans cette vie. Les petits garçons de cinq ans disparaissaient sans laisser de trace, en quelques secondes à peine… Une otarie pouvait bien être porteuse d’un message. Ce qu’elle m’a confié ce jour-là, collée à la vitre, si près de moi, c’était un message de résignation. « Cela suffit », a-t-elle dit. « Ne viens plus. Il ne reviendra pas. Tu dois lâcher prise. Tu dois le laisser s’en aller. » D’un coup de queue, elle est partie à l’autre bout du bassin, et seules les bulles qui remontaient à la surface prouvaient qu’elle avait été là l’instant d’avant. En touchant la surface de l’eau les bulles ont disparu à leur tour. Ce qui me tenait debout m’a quitté, ce mélange d’incrédulité et de refus de la réalité. J’ai glissé le long de la paroi et j’ai pleuré. Longtemps. Quand l’épuisement a tari mes larmes le zoo était presque vide. Je suis parti et n’y ai plus jamais remis les pieds. Je me sentais étrangement léger, j’en étais presque honteux. J’avais l’impression soudain d’avoir tout compris. Juliette ne fut pas de cet avis. Quand j’ai tenté de lui expliquer cette révélation, elle a eu ce regard étrange, vide, qui me signifiait que j’étais devenu un parfait étranger pour elle. Puis ses traits se sont déformés sous le coup de la rage, et tout est devenu très laid. Elle a hurlé que j’étais un salaud, que je ne pouvais abandonner notre fils comme ça, qu’elle ne lâcherait jamais prise, jamais, que ce serait comme mourir, que j’étais faible et lâche et qu’elle se battrait sans moi. Après ça le divorce a vite été prononcé. J’ai quitté la région et n’ai plus jamais eu de nouvelles de Juliette. Jusqu’à ce soir-là, avec ce Mathieu et ses cernes devant ma porte. J’ignore si c’est l’alcool ou cette fabuleuse capacité de mon esprit à jeter un voile noir sur les moments douloureux, mais je ne sais plus très bien ce que j’ai dit à cet homme. Je crois que je lui ai raconté l’essentiel de ce qu’il devait savoir car il a fini par partir. Lui ai-je expliqué l’histoire de l’otarie ? M’a-t-il pris lui aussi pour un fou ? Je l’ignore. Et ça n’a aucune importance. Sur le pas de la porte il s’est retourné vers moi et a saisi ma main. « Je vous remercie pour votre aide. Vraiment. Je suis désolé de ce qui vous est arrivé. Je vous tiendrai au courant, pour Juliette, c’est promis. » Trois jours plus tard, il m’a appelé. Ils avaient retrouvé son corps dans le Rhin.
Tonton Georges
-
Aujourd'hui un texte très court, inspiré par une photo de Bonze. Laissez-moi vous présenter Tonton G…
-
25 Jul 2013
La morte éveillée
-
Nouveau texte sur une photo de Bonze, avec Marikeira devant l'objectif :
On l’a appelée ai…
-
15 Jun 2013
See all articles...
Keywords
Authorizations, license
-
Visible by: Everyone (public). -
All rights reserved
-
1 039 visits
Lâcher prise
Nouvelle photo de Bonze, prise au zoo de Rotterdam. Aussi étrange que cela puisse paraître, ça en raconte, des choses, une otarie qui vous regarde.
L’homme qui se tenait en face de moi, assis bien droit sur le canapé, m’a tendu une enveloppe lilas. Il s’appelait Mathieu et, pour autant que je pouvais en juger, devait avoir sensiblement mon âge. Je ne savais pas ce qu’il attendait de moi, mais ses traits tirés et les cernes sous ses yeux n’auguraient rien de bon. Il m’avait juste dit qu’il était le nouveau compagnon de Juliette. Sur l’enveloppe était inscrit mon prénom, de cette écriture fine et déliée que j’avais connue dans une autre vie. Ces six lettres à l’encre noire me faisaient chavirer. Je ne voulais pas savoir, je ne voulais pas ouvrir cette boîte de Pandore. C’était il y a longtemps, Juliette n’était plus ma femme, nous avions rompu tout contact par un accord tacite et je ne voulais plus regarder de ce côté. J’avais déménagé, changé de région, jeté tout ce qui avait appartenu à celui qui était devenu un étranger pour moi. Je ne voulais pas. Mais l’autre était là, triturant ses mains, le regard implorant. « S’il vous plaît… Je suis désolé, j’ai lu cette lettre parce que c’est tout ce qu’elle a laissé. Cela fait quatre jours déjà qu’elle a disparu, vous êtes mon seul espoir de retrouver Juliette. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi. » Une grande lassitude m’a envahi. J’ai sorti la bouteille de gin et deux verres. Il faudrait bien ça. Tout ce qu’il savait, c’est que Juliette et moi avions été mariés, et que nous nous étions séparés presque dix ans plus tôt. Il en ignorait la raison, Juliette n’ayant jamais voulu aborder le sujet. Qui était ce « Jonas » dont elle parlait dans sa lettre ? Le prénom interdit a fait disparaître le sol sous mes pieds. Je suis tombé à nouveau, happé par cette chute sans fin. Le vertige. Le vide absolu, à nouveau. J’ai ouvert l’enveloppe. « Te souviens-tu, Arthus, de ce que tu m’as dit ce jour-là en rentrant du zoo ? Cette histoire d’otarie, de compréhension soudaine et totale ? Je t’avais pris pour un fou. Je t’avais lancé à la figure tout ce qui me tombait sous la main, parce que c’était trop tôt, pour moi. J’ai compris le sens de tes mots ce matin. Je passais par le parc en allant au bureau. J’ai vu une maman qui traînait son petit garçon pour aller à l’école. Il paraissait si petit, avec son énorme cartable sur le dos. Il me faisait tant penser à Jonas que j’ai failli courir vers lui et le serrer dans mes bras. Il s’est tourné vers moi, se sentant peut-être observé, et a eu cet étrange regard. Quelque chose entre l’étonnement et la pitié. J’ai eu mon message, moi aussi, même si c’est arrivé bien plus tard que pour toi. Ses yeux m’ont dit que Jonas ne lui ressemblerait plus, qu’il aurait seize ans à présent, mais que de toute façon il n’en avait même jamais eu six. J’ai compris tout cela en une fraction de seconde. La mort, l’otarie, l’éternité. Tout. Pardonne-moi de ne pas t’avoir compris ce jour-là. » Il m’a fallu quelques secondes pour reprendre pied avec la réalité. Un gouffre béant venait de s’ouvrir dans ma poitrine. J’ai bu deux verres de gin d’affilée et j’ai regardé cet homme hagard qui, hésitant, a fini par avaler à son tour le contenu de son verre cul-sec. « On ne peut pas disparaître comme ça… », a-t-il murmuré. J’ai réprimé un rire amer. Sans doute avais-je dit une imbécilité de la sorte, onze ans plus tôt. Peut-être au gardien du zoo, ou à un flic plus tard. Ou bien à elle ? Non, pitié. Je ne sais plus. Jonas avait cinq ans lorsqu’il a disparu. Quand nous l’avons perdu. Nous avions décidé d’aller nous promener au zoo tous les trois, il aimait tellement ça, surtout les crocodiles, qu’il pouvait observer sans bouger pendant de longues minutes. Le crocodile finissait par cligner d’un oeil ou remuer légèrement sa gueule, et alors Jonas s’écriait « Ha ! Je t’ai vu ! T’es vivant, t’as bougé! ». Immanquablement. Ce jour-là rien n’était différent. Nous étions devant le bassin des otaries, collés à la vitre, observant leur ballet avec une joie enfantine. Elles plongeaient, filaient à toute allure sous l’eau puis sautaient et retombaient lourdement dans de grosses éclaboussures. Parfois l’une d’elle venait se frotter à la vitre, ou coller ses moustaches à notre nez, quelques centimètres de plexiglas pour nous séparer, à peine. Je me souviens m’être relevé en souriant. J’ai cherché Jonas des yeux pour lui dire « Tu as vu ça? », mais il n’était plus là. J’ai demandé à Juliette « Où est Jonas ?», bêtement, comme pour avoir encore juste quelques secondes de répit, quelques secondes encore dans le monde stable des gens normaux. Quelques secondes où notre fils n’avait pas encore disparu. Oh si, on pouvait disparaître comme ça. Un claquement de doigt, puis le néant. Le scénario de ce qui s’était passé, nous l’avons refait des centaines, des milliers de fois, Juliette et moi. Les peut-être ont labouré ce qui restait de nous. Peut-être qu’il avait voulu aller voir de l’autre côté du bassin. Peut-être qu’il avait continué vers les tortues de mer. Peut-être que l’odeur de barbe à papa du stand voisin l’avait attiré. Peut-être que quelqu’un lui avait pris la main. Juliette qui se réveillait en hurlant, la nuit. « J’ai cru l’entendre, il m’appelait, peut-être qu’il m’appelle en ce moment, peut-être qu’il a mal?! ». Son regard éperdu, ses cheveux de folle qu’elle ne brossait plus. Trois verres de plus effacèrent son visage de mon esprit. Peut-être que des couples se sortaient de ça à deux. Ce ne fut pas notre cas. Nous nous accrochions l’un à l’autre comme deux naufragés mais cela n’aidait en rien. Au début nous restions ensemble pour toutes les démarches, répondre aux questions, coller des affiches, demander des nouvelles de l’enquête. Ce que je faisais seul, en cachette, c’était retourner là-bas. Devant le bassin des otaries. Je pouvais y rester des heures. J’ignore ce que je cherchais, ce que j’attendais, si j’attendais même quoi que ce soit. Il fallait que j’y aille, c’est tout. Les gens du zoo étaient pleins de compassion, on me laissait rentrer gratuitement, on me souriait gentiment, on ravalait une larme devant le triste spectacle que j’offrais. On tentait de me glisser dans de la ouate, « après ce qu’il a vécu comprenez-vous », mais bien sûr rien ne pouvait me soustraire à la torture. J’étais parti bien loin des gens et de leur monde où les enfants ne disparaissent pas comme ça. Et puis, un peu plus d’un an après la disparition, cette otarie. J’étais devant le bassin depuis si longtemps, je ne sais plus. La plus grosse, la plus vieille, celle que nous appelions « la Sage » avec Jonas, s’est approchée de la vitre. Je ne me souviens de rien de cette époque, mais cette image est restée gravée en moi. Elle a incliné la tête et a planté ses yeux dans les miens. Elle a cessé de bouger pendant un court instant, et soudain, tout en me regardant, elle a relâché un gros paquet de bulles. Elle m’a délivré son message et Juliette m’a hurlé que je devenais fou quand je le lui ai dit, ce soir-là. Cela m’importait peu, puisque rien n’était sensé dans cette vie. Les petits garçons de cinq ans disparaissaient sans laisser de trace, en quelques secondes à peine… Une otarie pouvait bien être porteuse d’un message. Ce qu’elle m’a confié ce jour-là, collée à la vitre, si près de moi, c’était un message de résignation. « Cela suffit », a-t-elle dit. « Ne viens plus. Il ne reviendra pas. Tu dois lâcher prise. Tu dois le laisser s’en aller. » D’un coup de queue, elle est partie à l’autre bout du bassin, et seules les bulles qui remontaient à la surface prouvaient qu’elle avait été là l’instant d’avant. En touchant la surface de l’eau les bulles ont disparu à leur tour. Ce qui me tenait debout m’a quitté, ce mélange d’incrédulité et de refus de la réalité. J’ai glissé le long de la paroi et j’ai pleuré. Longtemps. Quand l’épuisement a tari mes larmes le zoo était presque vide. Je suis parti et n’y ai plus jamais remis les pieds. Je me sentais étrangement léger, j’en étais presque honteux. J’avais l’impression soudain d’avoir tout compris. Juliette ne fut pas de cet avis. Quand j’ai tenté de lui expliquer cette révélation, elle a eu ce regard étrange, vide, qui me signifiait que j’étais devenu un parfait étranger pour elle. Puis ses traits se sont déformés sous le coup de la rage, et tout est devenu très laid. Elle a hurlé que j’étais un salaud, que je ne pouvais abandonner notre fils comme ça, qu’elle ne lâcherait jamais prise, jamais, que ce serait comme mourir, que j’étais faible et lâche et qu’elle se battrait sans moi. Après ça le divorce a vite été prononcé. J’ai quitté la région et n’ai plus jamais eu de nouvelles de Juliette. Jusqu’à ce soir-là, avec ce Mathieu et ses cernes devant ma porte. J’ignore si c’est l’alcool ou cette fabuleuse capacité de mon esprit à jeter un voile noir sur les moments douloureux, mais je ne sais plus très bien ce que j’ai dit à cet homme. Je crois que je lui ai raconté l’essentiel de ce qu’il devait savoir car il a fini par partir. Lui ai-je expliqué l’histoire de l’otarie ? M’a-t-il pris lui aussi pour un fou ? Je l’ignore. Et ça n’a aucune importance. Sur le pas de la porte il s’est retourné vers moi et a saisi ma main. « Je vous remercie pour votre aide. Vraiment. Je suis désolé de ce qui vous est arrivé. Je vous tiendrai au courant, pour Juliette, c’est promis. » Trois jours plus tard, il m’a appelé. Ils avaient retrouvé son corps dans le Rhin.
L’homme qui se tenait en face de moi, assis bien droit sur le canapé, m’a tendu une enveloppe lilas. Il s’appelait Mathieu et, pour autant que je pouvais en juger, devait avoir sensiblement mon âge. Je ne savais pas ce qu’il attendait de moi, mais ses traits tirés et les cernes sous ses yeux n’auguraient rien de bon. Il m’avait juste dit qu’il était le nouveau compagnon de Juliette. Sur l’enveloppe était inscrit mon prénom, de cette écriture fine et déliée que j’avais connue dans une autre vie. Ces six lettres à l’encre noire me faisaient chavirer. Je ne voulais pas savoir, je ne voulais pas ouvrir cette boîte de Pandore. C’était il y a longtemps, Juliette n’était plus ma femme, nous avions rompu tout contact par un accord tacite et je ne voulais plus regarder de ce côté. J’avais déménagé, changé de région, jeté tout ce qui avait appartenu à celui qui était devenu un étranger pour moi. Je ne voulais pas. Mais l’autre était là, triturant ses mains, le regard implorant. « S’il vous plaît… Je suis désolé, j’ai lu cette lettre parce que c’est tout ce qu’elle a laissé. Cela fait quatre jours déjà qu’elle a disparu, vous êtes mon seul espoir de retrouver Juliette. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi. » Une grande lassitude m’a envahi. J’ai sorti la bouteille de gin et deux verres. Il faudrait bien ça. Tout ce qu’il savait, c’est que Juliette et moi avions été mariés, et que nous nous étions séparés presque dix ans plus tôt. Il en ignorait la raison, Juliette n’ayant jamais voulu aborder le sujet. Qui était ce « Jonas » dont elle parlait dans sa lettre ? Le prénom interdit a fait disparaître le sol sous mes pieds. Je suis tombé à nouveau, happé par cette chute sans fin. Le vertige. Le vide absolu, à nouveau. J’ai ouvert l’enveloppe. « Te souviens-tu, Arthus, de ce que tu m’as dit ce jour-là en rentrant du zoo ? Cette histoire d’otarie, de compréhension soudaine et totale ? Je t’avais pris pour un fou. Je t’avais lancé à la figure tout ce qui me tombait sous la main, parce que c’était trop tôt, pour moi. J’ai compris le sens de tes mots ce matin. Je passais par le parc en allant au bureau. J’ai vu une maman qui traînait son petit garçon pour aller à l’école. Il paraissait si petit, avec son énorme cartable sur le dos. Il me faisait tant penser à Jonas que j’ai failli courir vers lui et le serrer dans mes bras. Il s’est tourné vers moi, se sentant peut-être observé, et a eu cet étrange regard. Quelque chose entre l’étonnement et la pitié. J’ai eu mon message, moi aussi, même si c’est arrivé bien plus tard que pour toi. Ses yeux m’ont dit que Jonas ne lui ressemblerait plus, qu’il aurait seize ans à présent, mais que de toute façon il n’en avait même jamais eu six. J’ai compris tout cela en une fraction de seconde. La mort, l’otarie, l’éternité. Tout. Pardonne-moi de ne pas t’avoir compris ce jour-là. » Il m’a fallu quelques secondes pour reprendre pied avec la réalité. Un gouffre béant venait de s’ouvrir dans ma poitrine. J’ai bu deux verres de gin d’affilée et j’ai regardé cet homme hagard qui, hésitant, a fini par avaler à son tour le contenu de son verre cul-sec. « On ne peut pas disparaître comme ça… », a-t-il murmuré. J’ai réprimé un rire amer. Sans doute avais-je dit une imbécilité de la sorte, onze ans plus tôt. Peut-être au gardien du zoo, ou à un flic plus tard. Ou bien à elle ? Non, pitié. Je ne sais plus. Jonas avait cinq ans lorsqu’il a disparu. Quand nous l’avons perdu. Nous avions décidé d’aller nous promener au zoo tous les trois, il aimait tellement ça, surtout les crocodiles, qu’il pouvait observer sans bouger pendant de longues minutes. Le crocodile finissait par cligner d’un oeil ou remuer légèrement sa gueule, et alors Jonas s’écriait « Ha ! Je t’ai vu ! T’es vivant, t’as bougé! ». Immanquablement. Ce jour-là rien n’était différent. Nous étions devant le bassin des otaries, collés à la vitre, observant leur ballet avec une joie enfantine. Elles plongeaient, filaient à toute allure sous l’eau puis sautaient et retombaient lourdement dans de grosses éclaboussures. Parfois l’une d’elle venait se frotter à la vitre, ou coller ses moustaches à notre nez, quelques centimètres de plexiglas pour nous séparer, à peine. Je me souviens m’être relevé en souriant. J’ai cherché Jonas des yeux pour lui dire « Tu as vu ça? », mais il n’était plus là. J’ai demandé à Juliette « Où est Jonas ?», bêtement, comme pour avoir encore juste quelques secondes de répit, quelques secondes encore dans le monde stable des gens normaux. Quelques secondes où notre fils n’avait pas encore disparu. Oh si, on pouvait disparaître comme ça. Un claquement de doigt, puis le néant. Le scénario de ce qui s’était passé, nous l’avons refait des centaines, des milliers de fois, Juliette et moi. Les peut-être ont labouré ce qui restait de nous. Peut-être qu’il avait voulu aller voir de l’autre côté du bassin. Peut-être qu’il avait continué vers les tortues de mer. Peut-être que l’odeur de barbe à papa du stand voisin l’avait attiré. Peut-être que quelqu’un lui avait pris la main. Juliette qui se réveillait en hurlant, la nuit. « J’ai cru l’entendre, il m’appelait, peut-être qu’il m’appelle en ce moment, peut-être qu’il a mal?! ». Son regard éperdu, ses cheveux de folle qu’elle ne brossait plus. Trois verres de plus effacèrent son visage de mon esprit. Peut-être que des couples se sortaient de ça à deux. Ce ne fut pas notre cas. Nous nous accrochions l’un à l’autre comme deux naufragés mais cela n’aidait en rien. Au début nous restions ensemble pour toutes les démarches, répondre aux questions, coller des affiches, demander des nouvelles de l’enquête. Ce que je faisais seul, en cachette, c’était retourner là-bas. Devant le bassin des otaries. Je pouvais y rester des heures. J’ignore ce que je cherchais, ce que j’attendais, si j’attendais même quoi que ce soit. Il fallait que j’y aille, c’est tout. Les gens du zoo étaient pleins de compassion, on me laissait rentrer gratuitement, on me souriait gentiment, on ravalait une larme devant le triste spectacle que j’offrais. On tentait de me glisser dans de la ouate, « après ce qu’il a vécu comprenez-vous », mais bien sûr rien ne pouvait me soustraire à la torture. J’étais parti bien loin des gens et de leur monde où les enfants ne disparaissent pas comme ça. Et puis, un peu plus d’un an après la disparition, cette otarie. J’étais devant le bassin depuis si longtemps, je ne sais plus. La plus grosse, la plus vieille, celle que nous appelions « la Sage » avec Jonas, s’est approchée de la vitre. Je ne me souviens de rien de cette époque, mais cette image est restée gravée en moi. Elle a incliné la tête et a planté ses yeux dans les miens. Elle a cessé de bouger pendant un court instant, et soudain, tout en me regardant, elle a relâché un gros paquet de bulles. Elle m’a délivré son message et Juliette m’a hurlé que je devenais fou quand je le lui ai dit, ce soir-là. Cela m’importait peu, puisque rien n’était sensé dans cette vie. Les petits garçons de cinq ans disparaissaient sans laisser de trace, en quelques secondes à peine… Une otarie pouvait bien être porteuse d’un message. Ce qu’elle m’a confié ce jour-là, collée à la vitre, si près de moi, c’était un message de résignation. « Cela suffit », a-t-elle dit. « Ne viens plus. Il ne reviendra pas. Tu dois lâcher prise. Tu dois le laisser s’en aller. » D’un coup de queue, elle est partie à l’autre bout du bassin, et seules les bulles qui remontaient à la surface prouvaient qu’elle avait été là l’instant d’avant. En touchant la surface de l’eau les bulles ont disparu à leur tour. Ce qui me tenait debout m’a quitté, ce mélange d’incrédulité et de refus de la réalité. J’ai glissé le long de la paroi et j’ai pleuré. Longtemps. Quand l’épuisement a tari mes larmes le zoo était presque vide. Je suis parti et n’y ai plus jamais remis les pieds. Je me sentais étrangement léger, j’en étais presque honteux. J’avais l’impression soudain d’avoir tout compris. Juliette ne fut pas de cet avis. Quand j’ai tenté de lui expliquer cette révélation, elle a eu ce regard étrange, vide, qui me signifiait que j’étais devenu un parfait étranger pour elle. Puis ses traits se sont déformés sous le coup de la rage, et tout est devenu très laid. Elle a hurlé que j’étais un salaud, que je ne pouvais abandonner notre fils comme ça, qu’elle ne lâcherait jamais prise, jamais, que ce serait comme mourir, que j’étais faible et lâche et qu’elle se battrait sans moi. Après ça le divorce a vite été prononcé. J’ai quitté la région et n’ai plus jamais eu de nouvelles de Juliette. Jusqu’à ce soir-là, avec ce Mathieu et ses cernes devant ma porte. J’ignore si c’est l’alcool ou cette fabuleuse capacité de mon esprit à jeter un voile noir sur les moments douloureux, mais je ne sais plus très bien ce que j’ai dit à cet homme. Je crois que je lui ai raconté l’essentiel de ce qu’il devait savoir car il a fini par partir. Lui ai-je expliqué l’histoire de l’otarie ? M’a-t-il pris lui aussi pour un fou ? Je l’ignore. Et ça n’a aucune importance. Sur le pas de la porte il s’est retourné vers moi et a saisi ma main. « Je vous remercie pour votre aide. Vraiment. Je suis désolé de ce qui vous est arrivé. Je vous tiendrai au courant, pour Juliette, c’est promis. » Trois jours plus tard, il m’a appelé. Ils avaient retrouvé son corps dans le Rhin.
Jump to top
RSS feed- Latest comments - Subscribe to the feed of comments related to this post
- ipernity © 2007-2025
- Help & Contact
|
Club news
|
About ipernity
|
History |
ipernity Club & Prices |
Guide of good conduct
Donate | Group guidelines | Privacy policy | Terms of use | Statutes | In memoria -
Facebook
Twitter
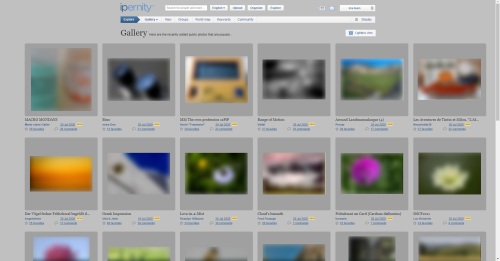



Sign-in to write a comment.