Eh oui, le mois de janvier est terminé, les bonnes résolutions également, et les affaires reprennent ! J'arrête donc d'arrêter de tuer des gens, mais pour me faire pardonner j'essaie de le faire avec un peu d'humour. Pas de photo cette fois-ci, en revanche : cette histoire m'est venue toute seule comme une grande.
Et s'intitule donc "Quand Papi a tué Mamie".
C'est sans doute en passant les vacances de mon enfance chez mes grands-parents que j'ai le plus élargi mon vocabulaire animalier. Non qu'ils eussent une ferme, ni de beaux livres d'images comme on en imagine au fond des placards de nos aïeux : je dois cette précoce richesse langagière aux mots que mon Papi crachait dans sa barbe, ainsi qu'à l'encyclopédie illustrée en douze volumes qui trônait dans la bibliothèque. En effet, il était fort rare que passe un jour sans que j'en soustraie un volume, afin de comprendre en quoi la peau douce et ridée de ma Mamie pouvait se rapprocher de celle d'une vache, ou pour comparer, dubitatif, son visage avec une "gueule de raie". Mamie avait bien quelques taches de vieillesse sur les mains, mais elles n'avaient rien à voir avec les larges aplats noirs du troupeau du pré voisin. Elle n'avait pas non plus cette grosse bouche tombante ni ces yeux minuscules que l'on pouvait voir sur la planche d'illustrations des poissons d'eau de mer. Au fil de mes jeunes années, je ne compris pas davantage le rapprochement avec les vieilles biques, pintades, morues, baleines, hyènes, grenouilles de bénitier, chouettes, chiennes, sangsues, pies, vipères, guenons, truies, dindes, vautours, grues et autres punaises... Je tombais d'accord avec mon grand-père pour un seul animal : le serpent. Non pour son apparence, mais parce que Mamie sifflait à longueur de journée (sans toutefois sortir de langue fourchue : je le vérifiai un beau matin en faisant mine de jouer au docteur et de l'ausculter, ce qui me rassura grandement). En effet, lorsque mon grand-père pénétrait une zone inférieure à environ trois mètres autour de ma grand-mère, celle-ci plissait invariablement les yeux pour ce qui semblait être une revue détaillée des tares de son époux. Faux pli dans ses vêtements, tache sur sa chemise, geste maladroit ou assoupissement impromptu, éternuement jugé trop puissant, visage mal rasé, lenteur de réaction, inactivité prolongée au-delà de dix minutes, pain mal coupé... rien en lui ne semblait trouver grâce à ses yeux. Aussi émettait-elle en permanence ce sifflement que j'associai, dès la première audition, à celui de ce serpent de dessin animé, aussi gigantesque que perfide, qui m'avait terrorisé un jour.
Ils étaient pourtant de formidables grands-parents : aimants, attentifs, généreux... Je garde de mes vacances chez eux d'excellents souvenirs, malgré les abîmes de perplexité dans lesquels me plongeaient ces rudoiements animaliers.
Je tentai bien, une fois ou deux, de demander quelques explications à ma mère, leur fille, mais je ne fus pas beaucoup plus avancé lorsqu'elle me répondit, excédée par un énième "pourquoi" : "Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ne savent pas faire autrement, c'est tout." Trop jeune pour comprendre la portée symbolique de ces mots, je m'imaginai alors un système complexe et invisible reliant mes grands-parents et leur permettant de "fonctionner", semblable aux mécanismes des vieilles montres que Papi trifouillait dans son atelier. Ainsi, surprenant un jour une conversation entre mes deux parents ("Cette tension permanente est insupportable ! s'emportait mon père. On a l'impression de sentir l'électricité dans l'air ! Peux-tu m'expliquer l'intérêt de vivre ensemble lorsqu'on se méprise à ce point ?"), me sentis-je soudain fort savant : dans le secret des dieux, j'avais compris que sans cette "électricité" dont parlait mon père, Papi et Mamie ne "fonctionneraient" plus. Ils tomberaient en panne, comme l'automate de la place de la mairie, qui restait le bras en l'air et le regard dans le vide tant que personne n'insérait une pièce dans le trou situé entre ses omoplates. Lors d'une autre "consultation médicale", offerte cette fois à mes deux grands-parents ("C'est à croire que ce petit deviendra médecin!" avaient-ils plaisanté, rare moment de connivence entre eux), je pus constater qu'ils n'avaient ni l'un ni l'autre de trou similaire dans le dos : cela devait fonctionner d'une autre façon chez eux.
L'apprentissage puis la maîtrise de la lecture devaient éclairer sous un jour nouveau (et bien plus angoissant) les relations entre mes grands-parents. J'avais surpris plus d'une fois ma grand-mère griffonner dans un petit carnet gris, qu'elle dissimulait ensuite soigneusement dans le coffret d'ébène de sa boîte à bijoux. Un après-midi pluvieux m'amena ainsi, vers neuf ou dix ans, jusqu'au petit carnet gris. Mamie était occupée à ses confitures, Papi lisait dans son fauteuil, et mon petit frère faisait la sieste : j'avais le champ libre pour un certain temps. C'est finalement moi que ce forfait devait léser le plus : les récriminations de Mamie à l'encontre de Papi s'y étalaient à pleines pages. Chaque mauvaise parole, chaque acte malveillant de mon grand-père y étaient recensés dans les moindres détails. Il semblait que sa vie entière soit consacrée à ce triste dessein : la faire souffrir. En échange de quoi, sa vie à elle semblait dédiée à l'inventaire de ses défauts. Je faisais difficilement le lien entre ce monstre et mon Papi qui, bien que parfois un peu abrupt, ne me semblait pas si diabolique que cela. C'est alors que je remarquai, au détour d'une page, quelques lignes tracées rageusement (on le voyait à la force avec laquelle elles avaient été écrites : les lettres réapparaissaient, gravées dans le papier, sur la dizaine de pages suivantes). Mamie y avait écrit ces mots, qui devaient hanter mes cauchemars plusieurs années durant : "Je voudrais qu'il meure." Glacé d'effroi, je refermai aussitôt le carnet et descendis en trombe les escaliers pour prévenir mon grand-père du danger qu'il courait. En arrivant dans le couloir qui menait au salon, je l'entendis en grande conversation avec un interlocuteur inconnu. Papi était en train de dresser la liste des défauts de ma grand-mère (elle semblait ne jamais finir), concluant par cette phrase, qui rejoignit celle de Mamie dans les cauchemars des années suivantes : "Je voudrais qu'elle disparaisse". Je restai tétanisé au milieu du couloir, voyant apparaître soudainement la situation dans toute son horreur : mes grands-parents voulaient se tuer.
L'innocence de mes jeunes années gît dans ce couloir. Depuis ce moment, cette idée m'obséda en permanence. L'angoisse agissait comme un révélateur et je voyais désormais toute la méchanceté déployée par chacun d'eux à l'encontre de la personne qu'ils rendaient responsable de tous leurs maux. Je ne pouvais voir Mamie saisir le couteau à viande d'un air décidé sans sentir mes jambes se dérober sous mon poids, ni Papi se lever brusquement de sa chaise, lorsque la conversation s'envenimait, sans que mon souffle reste suspendu, bloquant ma respiration jusqu'à ce qu'il sorte de la pièce sans saisir le chandelier de bronze qui était à portée de sa main.
Ce huis clos familial se prolongea pendant quelques années, durant lesquelles mes grands-parents gardèrent cette attitude haineuse l'un envers l'autre. Ma mère mit sur le compte de l'adolescence mes réticences à aller passer mes vacances chez eux. Elle ignorait que j'étais le détenteur d'un secret qui empoisonnait chaque instant passé à leurs côtés : aucun de leurs regards, gestes impatients, grognements ou sifflements n'échappait plus au filtre de mon angoisse. J'étais dans l'attente permanente de l'instant où l'un de deux remporterait cette course à l'assassinat. Serait-ce Papi, d'un coup de fourche dans la grange, ou par étranglement ? Ou bien Mamie, en empoisonnant sa soupe, ou abattant un marteau sur son crâne pendant sa sieste ? Et celui qui resterait, irait-il en prison ? À moins que le crime ne soit déguisé et jamais prouvé ? Dans ce cas, que ferais-je ? Faudrait-il choisir entre envoyer l'un des deux en prison ou laisser impuni le meurtre de l'autre ?
Un matin, un coup de téléphone vint conclure ces tourments de façon assez inattendue. Je vis le visage de ma mère se décomposer et l'entendis bégayer quelques questions ("Comment est-ce arrivé? Où ? "). Elle reposa le combiné et m'appela en sanglotant. "Mon chéri... il y a eu un accident. C'est terrible... Mamie est morte". Le couperet tombait enfin. Papi avait donc été le plus rapide. Je n'osai demander à ma mère des détails sur les circonstances du drame. Essaierait-elle de me mentir ? Savait-elle qu'il était le meurtrier ?
"C'est Papi?", balbutiai-je en redoutant sa réponse. "Oui, me répondit-elle... C'est Papi qui conduisait la voiture. Ils ont dérapé sur une plaque de verglas. Il est blessé lui aussi, mais il s'en sortira."
Quelque chose s'écroula en moi à cet instant. Une partie de mon cerveau, malgré l'évidence, refusait d'admettre qu'il s'agissait d'un vulgaire accident de la route. Cela revenait à ridiculiser, piétiner ces longues années d'angoisse, cette douleur qui m'étreignait la poitrine lorsque je lisais le mépris dans leurs yeux ou leurs paroles. Papi avait bien tué Mamie, mais comme ça, par mégarde, presque maladroitement. Ils n'avaient finalement empoisonné les vacances de mon enfance que pour cela, cette fin méprisable, sans cachet, sans superbe. À l'hôpital, je découvris mon grand-père fragile et perdu : le meurtrier en puissance venait de se transformer en faible vieillard. On aurait pu penser qu'après des années de haine farouche, le fait de ne plus "l'avoir sans cesse sur la couenne", comme il le disait souvent, lui offrirait une fin de vie plus heureuse et épanouie. Il n'en fut rien.
Comme l'automate de mon enfance, il commença à rester de longs moments sans bouger, le regard vide, comme s'il ne "fonctionnait plus". Il avait perdu son électricité, et en perdit également l'envie de bouger et de s'alimenter. Il se laissa dépérir, privé de celle qu'il aimait tant exécrer. Mamie tint sa revanche à peine six mois plus tard.
Le chauffeur
-
Toujours pas de photo pour cette nouvelle histoire qui a mis plusieurs années à émerger. Je la porta…
-
05 Mar 2014
Le plus beau jour de sa vie
-
Une nouvelle histoire illustrée par une photo de Bonze, dont vous pouvez retrouver le travail ici :…
-
03 Jan 2014
See all articles...
Keywords
Authorizations, license
-
Visible by: Everyone (public). -
All rights reserved
-
787 visits
Jump to top
RSS feed- Latest comments - Subscribe to the feed of comments related to this post
- ipernity © 2007-2025
- Help & Contact
|
Club news
|
About ipernity
|
History |
ipernity Club & Prices |
Guide of good conduct
Donate | Group guidelines | Privacy policy | Terms of use | Statutes | In memoria -
Facebook
X
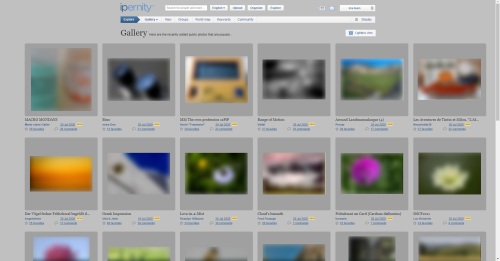

Sign-in to write a comment.